La démence vasculaire est l’une des causes de déclin cognitif les plus fréquentes après Alzheimer, mais elle reste souvent mal comprise. Elle survient quand la circulation sanguine du cerveau est altérée, entraînant des lésions qui perturbent la mémoire, l’attention et le comportement. Bien qu’elle soit complexe, elle n’est pas une fatalité. Un diagnostic précoce et une prise en charge ciblée permettent de ralentir l’évolution et d’améliorer la qualité de vie au quotidien.
💡 À retenir
- Environ 10% des cas de démence sont dus à des causes vasculaires.
- Données sur l’impact de la démence vasculaire sur la qualité de vie.
- Statistiques sur le diagnostic précoce et son effet sur le traitement.
Qu’est-ce que la démence vasculaire ?
La démence vasculaire correspond à un ensemble de troubles cognitifs causés par des lésions des vaisseaux sanguins cérébraux. Ces lésions privent certaines zones du cerveau d’oxygène et de nutriments, ce qui perturbe les fonctions mentales et motrices. On parle souvent de « déclin en marches d’escalier » car les capacités baissent par paliers après des événements vasculaires.
Cette forme de démence est étroitement liée aux maladies cardiovasculaires. Elle peut survenir après un accident vasculaire cérébral (AVC), plusieurs petits infarctus cérébraux « silencieux » ou une atteinte diffuse de la substance blanche. Au total, environ 10% des démences sont principalement vasculaires, et la proportion augmente quand il existe un mélange avec la maladie d’Alzheimer.
Les présentations varient. Certains patients ont des troubles de l’attention et du raisonnement très tôt, d’autres souffrent surtout de difficultés de marche et de ralentissement psychomoteur. Le point commun reste l’origine vasculaire des lésions qui rend l’évolution plus hétérogène que dans d’autres formes de démence.
Causes de la démence vasculaire
Les causes sont liées à une réduction de l’apport sanguin au cerveau. Les plus fréquentes sont les AVC ischémiques, l’athérosclérose des grosses artères, la maladie des petites artères (microangiopathie) et parfois des hémorragies cérébrales. Une fibrillation atriale non traitée peut envoyer des caillots au cerveau et multiplier les infarctus silencieux.
Avec l’âge, de minuscules vaisseaux se fragilisent et la substance blanche se détériore, un tableau souvent décrit comme leucoaraïose. Ce processus, lent mais cumulatif, peut suffire pour entraîner des troubles cognitifs significatifs quand il est étendu.
Facteurs de risque
- Hypertension artérielle mal contrôlée
- Diabète et dyslipidémie
- Tabagisme, sédentarité, obésité abdominale
- Fibrillation atriale et autres troubles du rythme
- Antécédents d’AVC ou d’ischémie transitoire
Plus ces facteurs sont présents, plus le risque augmente. Leur repérage et leur contrôle sont donc centraux pour prévenir ou ralentir la démence vasculaire.
Les différents types
On distingue classiquement la démence vasculaire post-AVC (déclin cognitif après un AVC documenté), la forme multi-infarctus (accumulation de petits infarctus), la forme sous-corticale liée à la maladie des petites artères, et les formes mixtes associant lésions vasculaires et dépôts amyloïdes. Cette typologie oriente les examens et la stratégie de prise en charge.
Symptômes de la démence vasculaire
Les symptômes dépendent des zones cérébrales touchées. Les premiers signes concernent souvent l’attention, la vitesse de traitement de l’information et la planification. Beaucoup décrivent un ralentissement dans les tâches complexes, des difficultés à organiser la journée et une fatigabilité cognitive marquée en fin d’après-midi.
La mémoire peut être atteinte, mais moins typiquement que dans la maladie d’Alzheimer. Les troubles exécutifs dominent: difficulté à changer de stratégie, à suivre une recette, à gérer un budget. Des changements de l’humeur et du comportement sont fréquents, comme l’irritabilité, l’apathie ou une dépression associée. Des troubles de la marche, un équilibre plus précaire et des chutes peuvent apparaître tôt.
La progression se fait souvent par paliers. Après un nouvel événement vasculaire, un palier de déclin s’installe, puis une phase de stabilité relative survient. Cette alternance explique que l’entourage perçoive des « coups de frein » successifs plus que la pente continue classiquement observée ailleurs.
Exemples du quotidien
- Impossible de se souvenir des étapes pour payer en ligne alors que le code est connu
- Besoin d’une liste détaillée pour les courses et oubli de la moitié des items sans support visuel
- Marche à petits pas avec difficultés à tourner et peur de tomber
- Changements d’humeur soudains face aux imprévus, repli social
Exemple concret: Paul, 72 ans, a subi un AVC mineur. Il va bien physiquement, mais il ne parvient plus à planifier ses rendez-vous ni à suivre ses papiers administratifs. Des séances d’orthophonie et l’utilisation d’un agenda partagé l’aident à retrouver un rythme plus serein.
Diagnostic et évaluation
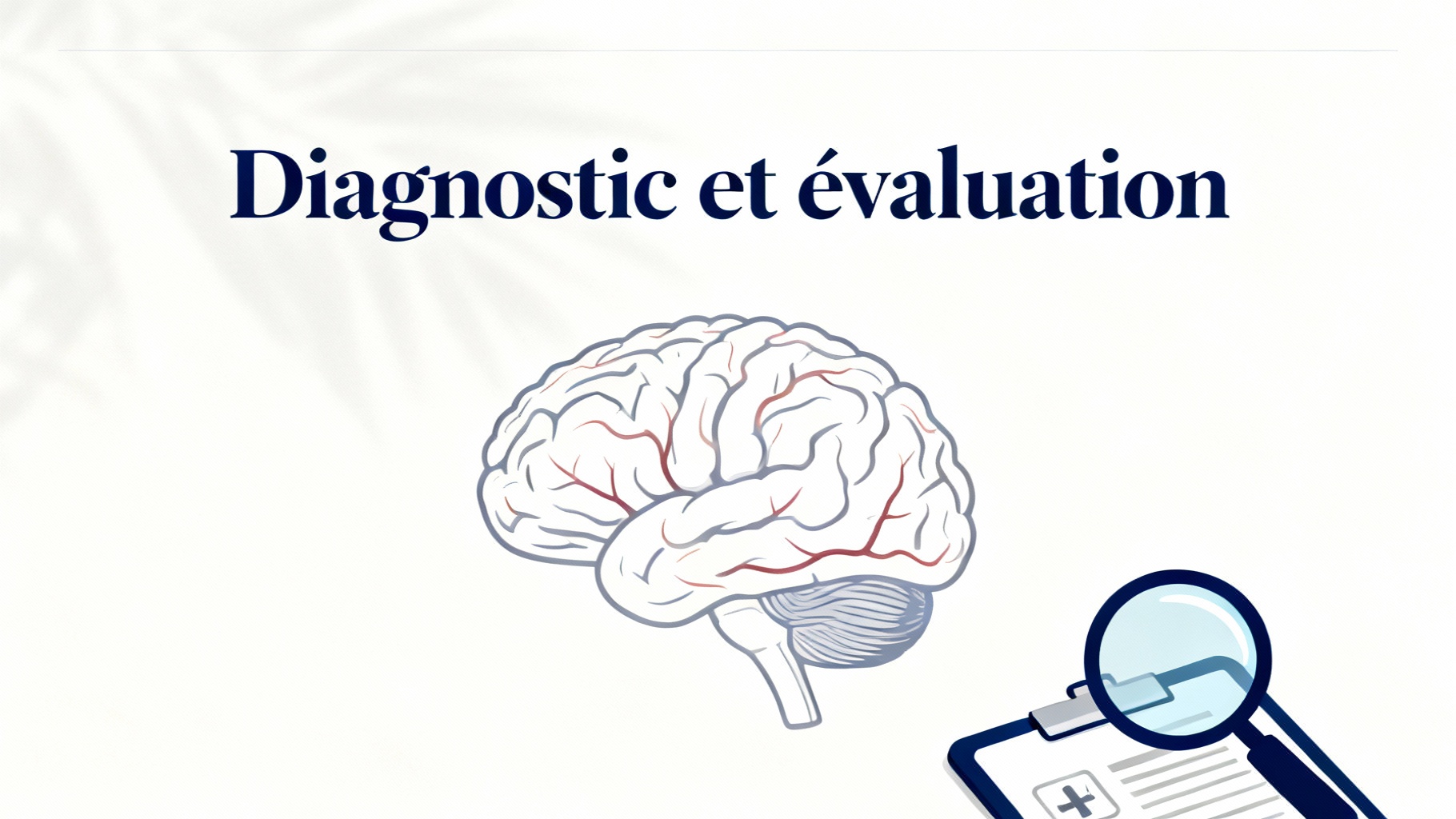
Le diagnostic s’appuie sur un faisceau d’arguments: histoire clinique compatible, facteurs de risque vasculaire, évaluation cognitive standardisée et imagerie cérébrale. L’objectif est double: confirmer l’atteinte cognitive et identifier la part vasculaire des lésions pour guider les traitements.
Un bilan complet recherche aussi des causes aggravantes et évitables comme un trouble du sommeil, une carence en vitamine B12, une hypothyroïdie ou des effets secondaires médicamenteux. Plus le diagnostic est précoce, plus il est possible d’agir sur les facteurs modifiables et de mettre en place des stratégies de compensation efficaces.
Tests de diagnostic
- Évaluations cognitives: MoCA, MMSE, tests exécutifs (Flexibilité mentale, Trail Making Test)
- Imagerie: IRM cérébrale de référence pour visualiser infarctus, lacunes et lésions de la substance blanche; scanner si IRM non disponible
- Bilan vasculaire: doppler des carotides, ECG pour dépister une fibrillation atriale
- Bilan biologique: glycémie, HbA1c, profil lipidique, fonction thyroïdienne, vitamine B12
La synthèse de ces éléments permet d’écarter d’autres causes de déclin cognitif et d’objectiver la contribution vasculaire. Un suivi régulier au centre mémoire ou avec un neurologue/gériatre affine le plan d’action.
Pourquoi le diagnostic précoce change la donne
Repérer tôt la démence vasculaire permet de démarrer le contrôle des facteurs de risque et les thérapies de réadaptation sans attendre. Dans les cohortes de patients ayant des antécédents d’AVC, une prise en charge rapide de l’hypertension et des troubles du rythme réduit le risque d’AVC récurrent d’environ 25%, ce qui limite les « paliers » de déclin.
Un diagnostic précoce facilite aussi l’adaptation du domicile, la simplification des traitements et la mise en place d’outils de compensation cognitive. Des études cliniques suggèrent que cette organisation peut retarder la perte d’autonomie de plusieurs mois et diminuer les réadmissions non programmées. Pour l’aidant, comprendre la maladie améliore la communication et réduit l’épuisement.
Options de traitement
Il n’existe pas un seul médicament qui « gomme » les lésions vasculaires, mais un ensemble d’actions coordonnées permet de stabiliser et parfois d’améliorer la situation. L’axe central consiste à protéger le cerveau de nouveaux dommages et à optimiser les fonctions encore intactes.
La stratégie combine traitement des facteurs de risque, prévention des événements vasculaires, réadaptation cognitive et physique, et soutien psychologique. Chaque plan est individualisé selon l’histoire clinique, l’imagerie et les priorités de la personne et de sa famille.
Médicaments et thérapies
- Prévention vasculaire: contrôle tensionnel, statines en cas d’athérosclérose, antiagrégants plaquettaires selon les antécédents, anticoagulation en cas de fibrillation atriale
- Symptômes cognitifs: inhibiteurs de l’acétylcholinestérase (ex. donepezil) ou mémantine peuvent apporter un bénéfice modeste chez certains patients
- Réadaptation: orthophonie pour l’attention et les fonctions exécutives, ergothérapie pour les activités de la vie quotidienne, kinésithérapie pour la marche et l’équilibre
- Santé mentale: prise en charge de l’anxiété et de la dépression, psychoéducation des proches
Côté pratiques, des séances courtes et fréquentes de stimulation cognitive, un programme de marche sécurisée et des rappels visuels à domicile font souvent une vraie différence. Exemple: installer une horloge-calendrier visible, utiliser un pilulier électronique et afficher une « routine du matin » au mur.
Quand des troubles du comportement apparaissent, privilégier d’abord les approches non pharmacologiques: repères visuels, environnement apaisé, activités familières. Les traitements médicamenteux de ces troubles sont réservés aux situations où la sécurité ou la qualité de vie sont en jeu, sous suivi médical rapproché.
Prévention et gestion
Prévenir la démence vasculaire, c’est surtout prendre soin des vaisseaux. Les mêmes mesures qui protègent le cœur protègent le cerveau. Réduire la pression artérielle, traiter le diabète, arrêter de fumer et bouger chaque jour sont des leviers puissants à tout âge.
Les bénéfices sont concrets. Une tension mieux contrôlée limite les lésions de la substance blanche, l’activité physique entretient la plasticité cérébrale et le sommeil profond consolide l’attention et la mémoire. Même après un premier événement vasculaire, une hygiène de vie adaptée peut freiner la progression.









